A travers nos différents podcasts, nous explorons l'univers fascinant du cerveau humain. Bienvenue dans ce nouvel épisode.
"Vie et mort des neurones ou
comment notre
cerveau se réinvente sans cesse"
Notre objectif n'est pas de plonger dans des détails hautement scientifiques, mais plutôt de susciter votre curiosité, de vous fournir des informations accessibles qui déconstruisent les intox et les idées reçues et de vous inviter à découvrir les mécanismes incroyables qui façonnent notre esprit. Nous espérons éveiller en vous l'envie d'en apprendre davantage et de consulter les publications scientifiques sur le sujet.
Alors si vous êtes prêt à embarquer pour ce voyage neuronal ? C’est parti !
Les scientifiques sont tous d’accord sur un point : notre cerveau est un système dynamique en perpétuelle reconfiguration.
Neurogenèse prénatale - Neuroplasticité - Apoptose – Neurogenèse adulte: des concepts distincts mais complémentaires
Commençons par le début avec la naissance des neurones – La neurogenèse prénatale
La neurogenèse est le processus biologique par lequel de nouveaux neurones (cellules nerveuses) sont générés dans le cerveau. Elle est particulièrement active pendant la période prénatale, lorsque le cerveau du fœtus se forme, et joue un rôle clé dans la structuration des circuits neuronaux.
Ce phénomène se produit principalement dans certaines zones du cerveau, comme l'hippocampe, une région associée à la mémoire et à l'apprentissage.
Pendant la grossesse, des millions de neurones se forment chaque jour, principalement dans la zone ventriculaire du cerveau. Ces cellules migrent ensuite vers leur destination finale.
Commençons par quelques chiffres : Le cerveau d'un jeune adulte humain contient environ 86 milliards de neurones. Ce chiffre a été établi par des recherches récentes, notamment celles de la neuroscientifique brésilienne Suzana Herculano-Houzel (1), qui a utilisé une méthode innovante appelée "fractionnement isotropique" pour compter les neurones. Selon la scientifique la quantité de neurones de l’encéphale aurait été surestimée... de 14 milliards. Au lieu des 100 milliards régulièrement admis, nous ne disposerions donc que de 86 milliards de cellules nerveuses.
La répartition approximative serait :
- 16 milliards de neurones dans le cortex cérébral
- 69 milliards de neurones dans le cervelet (représentant la majorité des neurones, bien que cette région soit plus petite en volume).
- 1 milliard de neurones dans le tronc cérébral et autres structures sous-corticales
L'âge d'un "jeune adulte" est généralement considéré comme se situant entre 18 et 25 ans, bien que cette définition puisse varier légèrement selon les contextes culturels et scientifiques. Cette période correspond à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, marquée par une maturation cérébrale et physique significative.
À cet âge, le cerveau a atteint sa taille adulte maximale (environ 1,3 à 1,4 kg).
Cependant, la maturation n'est pas encore totalement achevée : le cortex préfrontal, impliqué dans la prise de décision et le contrôle des impulsions, continue de se développer jusqu'à environ 25 ans.
Contrairement aux analogies que certains utilisent, notre cerveau n’est pas un coffret électrique rigidement figé et câblé !
La compréhension des mécanismes neuronaux progresse rapidement. Certains scientifiques commencent à stimuler le cerveau dans sa capacité de créer de nouvelles connections neuronales. Je vous en parle un peu plus loin.
Notre cerveau serait donc en perpétuelle évolution !
C’est prouvé ! Notre cerveau a la capacité à se réorganiser en réponse à des changements environnementaux, des apprentissages ou des lésions. C’est la neuroplasticité, ce mécanisme est essentiel à notre capacité d'apprendre et de nous adapter. Il est différent d’un individu à un autre.
Comme le dit Jean Pierre Changeux professeur à l’institut Pasteur : « c’est de la modification des réseaux neuronaux que naît la diversité des individus ».
La neuroplasticité est la capacité du cerveau à se restructurer en modifiant les connexions entre les neurones existants.
Elle repose sur l'amélioration ou la réduction des synapses (les points de communication entre les neurones), plutôt que sur la création de nouveaux neurones.
La neuroplasticité est au cœur des mécanismes d'apprentissage, de mémorisation, et de réhabilitation cognitive.
Son rôle clé est l'daptation à de nouvelles compétences : apprendre un instrument de musique, une nouvelle langue ou même des tâches complexes.
Un autre rôle est la récupération après un accident vasculaire cérébral (AVC), où d’autres zones saines du cerveau compensent les fonctions perdues dans les zones atteintes.
L'environnement et surtout un milieu enrichissant stimulent la création de nouvelles connexions synaptiques.
Bien que la neuroplasticité soit plus importante chez les enfants, elle reste présente tout au long de la vie.
En parlant d’environnement et de contexte, je vous invite à lire les abstracts des études d’ Eleanor McGuire de la University College London.
Cette neuroscientifique est célèbre pour ses recherches sur le rôle de l'hippocampe dans la navigation spatiale et la mémoire autobiographique. McGuire a mené des études sur les conducteurs de taxi londoniens, démontrant que leur hippocampe était plus développé que celui des personnes n'ayant pas de formation en navigation, en raison des compétences spatiales accrues nécessaires pour naviguer dans la ville.(2)
Notre cerveau est donc plastique et se modifie en permanence en réponse à notre environnement.
Cette neuroplasticité joue un rôle crucial dans le développement de l’individu, C’est une réalité bien connue et depuis longtemps.
Avant même l’avènement de l’imagerie médicale, le neuroanatomiste espagnol Santiago Ramón y Cajal avait apporté les premières preuves anatomiques de la plasticité cérébrale. Bien que les grandes catégories de cellules du cerveau, comme les neurones pyramidaux du cortex, soient structurellement invariantes, leur connectivité peut se réorganiser après des lésions ou en réponse à différentes expériences.
Ramón y Cajal est considéré comme le père de la neuroanatomie moderne.
Né en 1852, décédé en 1934, il fut un scientifique visionnaire qui révolutionna notre compréhension du cerveau. En 1873, Camillo Golgi, médecin et histologiste italien, inventait une méthode de coloration histologique basée sur l'imprégnation argentique, permettant de visualiser des neurones entiers de manière détaillée, les rendant noirs sur un fond clair.
En utilisant et perfectionnant cette technique, Ramon y Cajal démontra pour la première fois que les neurones étaient des entités distinctes, réfutant ainsi la théorie du "réseau continu" qui prédominait à l’époque.
Ses travaux ont jeté les bases de la neuroscience moderne et de la compréhension de phénomènes tels que la plasticité cérébrale. Grâce à ces découvertes, Golgi et Cajal ont reçu conjointement le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1906.
Une autre étape dans le cycle du cerveau est l’apoptose naturelle
L’apoptose est un processus naturel de mort cellulaire programmée. Bien que cela puisse paraître négatif, l'apoptose est en réalité cruciale pour le bon développement et le maintien du cerveau.
Mort des neurones et son rôle bénéfique
Pendant l’enfance, elle permet d’éliminer les neurones en excès et les connexions inutiles, favorisant ainsi une communication optimale entre les réseaux neuronaux.
Elle contribue à éviter la formation de circuits dysfonctionnels.
Elle peut cependant créer des déséquilibres et pathologies
Une apoptose excessive est liée à des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson.
Une apoptose insuffisante peut conduire à des tumeurs, comme dans le cas des glioblastomes.
Des recherches ont montré que l’équilibre entre neurogenèse et apoptose est essentiel pour la santé cognitive et émotionnelle.
En 2000, Mark P. Mattson un neuroscientifique américain a publié plusieurs articles explorant l'équilibre entre la neurogenèse et l'apoptose dans le système nerveux. Dans "Apoptosis in neurodegenerative disorders", publié dans Nature Reviews Molecular Cell Biology, (3)
"On pensait que perdre des neurones était une fatalité...
C’est sans compter sur les travaux de María Llorens-Martín, qui révèlent qu’à l’âge adulte, notre cerveau peut encore en créer.
Une véritable révolution scientifique !"
Contrairement à ce qu'on pensait autrefois, la neurogenèse ne s'arrête pas après la naissance ; elle peut continuer tout au long de la vie, bien que son rythme diminue avec l'âge.
Le processus ralentit mais persiste dans certaines régions, notamment l’hippocampe, une structure essentielle à la mémoire et à l'apprentissage.
Des recherches comme celles de Pasko Rakic un neuroscientifique de l'Université Yale dans les années 1970 ont montré que, chez l’humain, la neurogenèse est limitée à certaines régions.
Cependant, des études plus récentes, notamment par Eriksson 1998, ont révélé que même les adultes produisent de nouveaux neurones dans l’hippocampe.
María Llorens-Martín, née en 1974, neuroscientifique espagnole renommée, chercheuse au Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) en Espagne, a réalisé des études pionnières sur la neurogenèse adulte. Ses recherches indiquent que la neurogenèse hippocampique persiste tout au long de la vie humaine, bien que diminuant avec l'âge. Elle a également démontré que ce processus est altéré chez les patients atteints de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer.
Le magazine Sciences a relayé les découvertes de l'équipe de la biologiste María Llorens-Martín. Ces scientifiques ont marqué un tournant dans l'étude du cerveau en 2020, lorsqu'ils ont identifié la présence de neurones immatures dans l'hippocampe des adultes.
Selon Llorens-Martín, « cela pourrait indiquer l'existence d'un processus de neurogenèse, où ces neurones se formeraient au cours de la vie adulte ». Leur recherche visait notamment à écarter l'hypothèse selon laquelle ces cellules, essentielles à la réception, au traitement et à la transmission de l'information, auraient été générées à la naissance, pour ensuite rester immatures, comme l'avaient supposé de nombreux scientifiques.
Grâce à l'analyse approfondie de 48 cerveaux adultes, dont 15 en parfaite santé cognitive, l'équipe de chercheurs a confirmé la présence de cellules souches et de leurs descendants (cellules filles), capables de se diviser rapidement, de mûrir et de produire de nouveaux neurones. Ces travaux ont également permis de conclure que ce n’est pas l’absence de ce mécanisme qui cause les maladies neurodégénératives, mais bien l’inverse : ces pathologies réduisent la capacité à générer de nouveaux neurones.
Avec cette découverte, Llorens-Martín a mis fin à des décennies de débats sur la neurogenèse adulte et ouvert la voie à des perspectives thérapeutiques prometteuses pour préserver cette aptitude tout au long de la vie. « Nous avons réussi à retracer, en quelque sorte, le parcours complet de ces nouveaux neurones : depuis leurs cellules souches d’origine jusqu’à leur maturation en neurones fonctionnels. Cela n'avait jamais été établi auparavant. On savait qu’ils existaient, mais leur origine demeurait inconnue », explique la chercheuse. (4)
Je joins quelques articles de référence que vous retrouverez à la fin de la version écrite de ce podcast. (5)
Comprendre la neurogenèse adulte pourrait donc ouvrir la voie à de nouvelles approches thérapeutiques dans le traitement des maladies neurodégénératives. En stimulant la production de neurones, on pourrait donc ralentir la progression de maladies comme Alzheimer.
Les recherches de Llorens-Martín suggèrent que la promotion de la neurogenèse pourrait être une stratégie viable pour remplacer les neurones perdus ou endommagés dans diverses conditions neurologiques. (6)
Neurogenèse adulte, apoptose, neuroplasticité... Ces mécanismes incroyables ne donnent leur plein potentiel que si nous prenons soin de notre cerveau.
« Devenons les acteurs clés de notre fantastique évolution cérébrale ! »
Voici quelques stratégies essentielles pour dynamiser et entretenir notre cerveau :
- Selon les études d’ Henriette Van Praag, une neuroscientifique néerlandaise, l’activité physique, les exercices réguliers, augmentent la neurogenèse et protègent les neurones existants. (7)
- L’apprentissage continu de nouvelles compétences stimule la création de nouvelles connexions synaptiques.
- La réduction du stress limite la destruction des neurones induite par le cortisol.
- Une alimentation saine : Les oméga-3 et les antioxydants présents dans les poissons gras, les noix et les baies favorisent un cerveau en santé.
- Des activités comme la lecture, les jeux de stratégie et des expériences nouvelles stimulent la plasticité neuronale.
Conclusion
Nous venons de traverser rapidement l’évolution fascinante des neurones depuis notre naissance, en explorant des concepts-clés comme la neurogenèse, la neuroplasticité et l'apoptose, ainsi que les dernières découvertes sur la naissance de nouveaux neurones chez les adultes.
Notre cerveau est un univers complexe, adaptatif et évolutif.
Prenons-en soin et stimulons-le, car il n’est jamais trop tard pour cultiver ses capacités !
Références :
(1) https://open.spotify.com/episode/57LsnR9zUMDXoIFLqHqXyx
(3) https://europepmc.org/article/MED/11253364?ut
(4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33762406/
(5) Quelques articles de référence :
- Evidences for Adult Hippocampal Neurogenesis in Humans : Cet article présente des preuves de la persistance de la neurogenèse hippocampique chez l'adulte humain et discute des implications pour les maladies neurodégénératives.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33762406/
- Adult hippocampal neurogenesis is abundant in neurologically healthy subjects and drops sharply in patients with Alzheimer's disease : Cette étude montre une diminution significative de la neurogenèse hippocampique chez les patients atteints d'Alzheimer, suggérant un lien entre la réduction de la neurogenèse et la progression de la maladie.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30911133/
- Impact of neurodegenerative diseases on human adult hippocampal neurogenesis : Cet article explore comment les maladies neurodégénératives affectent la neurogenèse adulte dans l'hippocampe humain, offrant des perspectives sur les mécanismes sous-jacents et les implications thérapeutiques potentielles.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7270?utm_source=chatgpt.com
(6) https://www.youtube.com/watch?v=CoDwRK3LUHc
https://www.youtube.com/watch?v=HARAnEmhj10
(7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10557337/
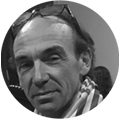
Fabrice
Mandelaire
Managing Director